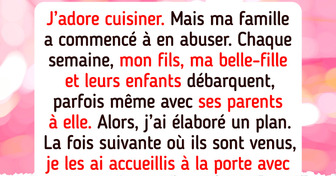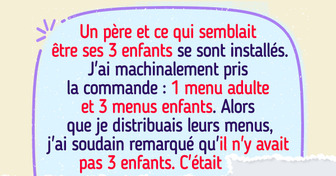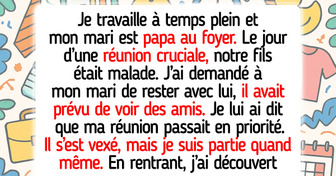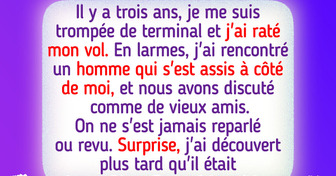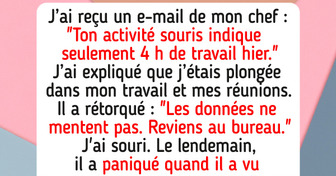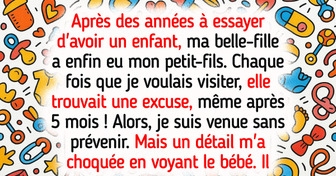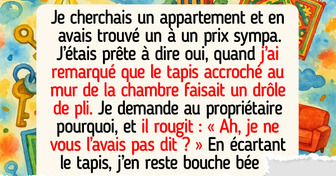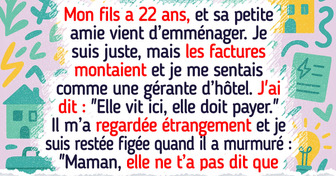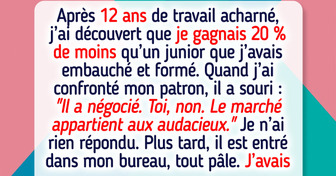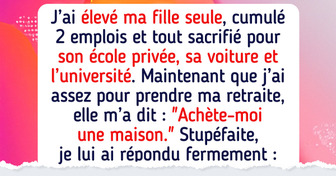12 Portraits qui prouvent que la retouche existait bien avant les réseaux sociaux


Au fil de l’histoire, la mode a vu défiler des vêtements qui, à première vue, semblaient extravagants ou tout simplement étranges. Des corsets rigides aux chapeaux aux formes improbables, ces pièces autrefois très prisées avaient des fonctions bien précises que l’on ne devine plus forcément aujourd’hui. Derrière leurs formes insolites se cachaient en réalité des usages pratiques ou des significations symboliques — des détails qui ne prennent tout leur sens qu’en les replaçant dans le contexte de leur époque.

Dans l’Angleterre des Tudor, le col en fraise s’impose comme un signe distinctif de raffinement et de statut social parmi l’élite. Mais derrière son allure théâtrale, il remplissait aussi une fonction hygiénique ingénieuse : servir de barrière protectrice pour éviter que la sueur et le sébum du cou ne tachent les vêtements, réduisant ainsi la fréquence des lavages. Amovible, il pouvait être nettoyé séparément, épargnant ainsi les habits plus complexes et difficiles à laver qui se portaient dessous.

Au Moyen Âge, les femmes — et parfois les hommes — affectionnaient particulièrement le bliaut, une robe fluide caractérisée par ses manches démesurément longues et traînantes. Aujourd’hui, elles sembleraient peu pratiques, mais cette gêne était volontaire : porter un tel vêtement indiquait que l’on appartenait à la haute société, assez riche pour se tenir éloigné des travaux manuels et afficher un luxe purement décoratif.

En Grèce antique, le himation était un manteau polyvalent, à la fois pratique et symbolique. Pour les femmes, il allait bien au-delà du simple vêtement : drapé sur tout le corps, il pouvait aussi recouvrir la tête et dissimuler les émotions. En cas de forte émotion ou par pudeur, elles s’enveloppaient de ce voile tissé, transformant l’étoffe en outil de retenue, de discrétion ou de décence dans l’espace public.

Le soleret était une sorte de chaussure d’armure portée par les chevaliers, faisant partie intégrante de leur tenue de combat. Constituée de plaques ou de lamelles métalliques superposées, elle alliait protection et souplesse. Outre la sécurité qu’elle offrait, elle facilitait aussi le combat à cheval : sa structure permettait de mieux accrocher les pieds aux étriers, assurant stabilité et contrôle lors des charges.

Dans l’art médiéval, on voit souvent des personnages habillés de vêtements coupés verticalement en deux couleurs contrastées : c’est le style dit mi-parti. Cette mode distinctive n’était pas simplement décorative ; elle avait une fonction sociale claire. Généralement porté par les serviteurs, le motif bicolore indiquait le rang du porteur au sein de la famille. Au fil du temps, ces combinaisons de couleurs ont évolué pour représenter la livrée des familles aristocratiques, transformant l’habit en véritable signe d’allégeance et de service

En 1571, le gouvernement anglais a introduit une loi visant à soutenir l’industrie lainière locale en imposant une loi obligeant toute personne de plus de six ans à porter un bonnet de laine le dimanche et les jours fériés. Cette mesure visait à faire prospérer les bonnetiers et à stimuler la production de laine. Bien que la loi ait été officiellement abrogée en 1597, la pratique du port du bonnet de laine a persisté, devenant une tradition familière au sein de la population bien après le retrait de l’obligation légale.

Les robes à manches gigot surdimensionnées, aussi appelées manches en jambe de mouton, étaient plus qu’un simple effet de mode. À l’instar des bliauts, ces manches spectaculaires signalaient qu’une femme appartenait à l’élite en soulignant son détachement du travail physique et sa préférence à ne pas travailler ; Leur ampleur exagérée rendait les mouvements difficiles, et lever les bras étaient presque impossible. En plus de symboliser la richesse et le raffinement, elles créaient aussi un effet visuel flatteur : associées à une jupe volumineuse et à un décolleté ouvert, elles créent l’illusion d’une taille beaucoup plus fine et cintrée, conforme à l’idéal de beauté féminine de l’époque

À la fin du XIXᵉ siècle, le plastron de smoking devient une solution à la fois élégante et pratique pour les hommes qui devaient porter un costume tous les jours, en particulier les hommes d’affaires. Cette pièce de poitrine détachable, dotée d’un col, a été conçue pour être portée sous une veste afin de donner l’apparence d’une chemise impeccable et fraîchement lavée. Pour de nombreux hommes d’affaires qui ne pouvaient pas se permettre de laver fréquemment des chemises complètes, les plastrons de smoking offraient une alternative abordable. Faciles à nettoyer et à entretenir, ils permettent non seulement d’économiser du temps et de l’argent, mais aussi de masquer les vêtements usés ou tachés sous la veste, au point d’être comparé à du maquillage pour leur capacité à dissimuler les défauts et à maintenir une apparence soignée.

À l'époque victorienne, le bonnet de nuit était incontournable pour les femmes, les enfants et les personnes âgées, et remplissaient à la fois un rôle pratique et culturel. Toutefois, au début du XXe siècle, ce vêtement autrefois indispensable est en désuétude et a rapidement été associé à une mode démodée et au mauvais goût. Il retrouve un second souffle vers 1910, quand les femmes ont commencé à le réintroduire dans leur routine nocturne, cette fois en mettant l'accent sur le soin capillaire.
Les bonnets de soie ont gagné en popularité grâce à leur capacité à protéger les cheveux pendant le sommeil : ils préservent leur douceur et leur brillance, limitent les nœuds et facilitent grandement la toilette du matin. Certaines variantes étaient même imprégnées de parfums, ce qui permettait aux femmes de se réveiller avec des cheveux à la fois beaux et agréablement odorants au matin. Loin d'être des vestiges du passé, ces bonnets sont devenus les premiers outils d'un monde en pleine évolution, celui de la beauté et du soin de soi.

Aujourd’hui perçu comme un vêtement d’extérieur pratique, le poncho revêtait autrefois une signification culturelle plus profonde dans diverses sociétés traditionnelles. Au-delà de la chaleur et de la protection contre les éléments, il servait souvent d’expression visuelle de l’identité et du rang social. Chez les Mapuches d’Amérique du Sud, par exemple, le poncho était plus qu’un simple vêtement : c’était un symbole d’autorité et de respect. Les ponchos ornés d’un motif rhomboïdal distinctif tissé dans le tissu était réservé aux anciens et aux chefs de la communauté, signifiant leur pouvoir et leur rôle au sein du groupe. Ils étaient portés lors de cérémonies importantes pour affirmer le statut de celui qui les portait grâce à un dessin significatif.

Les cinéphiles attentifs reconnaîtront peut-être un détail classique des films sur le Far West : les cow-boys portaient souvent, par-dessus leur pantalon, une couverture en cuir frangée, attachée à l’aide d’une ceinture. C’est ce qu’on appelle les chaps — abréviation de chaparejos — et c’était un élément essentiel de l’équipement des cow-boys, non pas pour le style, mais pour la survie.
Les chaps constituaient une solide couche de protection contre le terrain accidenté de la frontière américaine. Lorsqu’ils traversaient des broussailles épineuses, des cactus ou des sous-bois denses, les cow-boys risquaient de graves éraflures et coupures aux jambes. Fabriquées en cuir robuste, les chaps les protégeaient de ces dangers. En outre, le matériau offre une meilleure adhérence et un plus grand confort en selle, en réduisant le glissement — ce que les pantalons en tissu ordinaires n’arrivent pas à faire aussi bien. Les chaps étaient une solution pratique aux défis quotidiens de la vie à cheval.

Jusqu’aux années 1930, les habitants des Açores portaient de longs manteaux bleus appelés capote e capelo, dotés d’une grande capuche renforcée par des fanons de baleine. Ils reflétaient la vie locale : l’exportation de teinture bleue et la chasse à la baleine constituaient alors des piliers de l’économie. Ces manteaux, transmis de génération en génération, symbolisaient aussi l’identité culturelle des îles.
La mode évolue au fil du temps, reflétant les changements culturels, technologiques et sociétaux. Ici, on retrace le parcours de vêtements d’époque, passés du statut de nécessité pratique à celui d’icône de style. Et parce que l’histoire du vêtement est une éternelle réinvention, découvre aussi notre sélection de 10 vêtements ordinaires qui ont subi d’étonnantes métamorphoses au cours du siècle dernier.