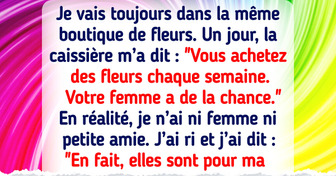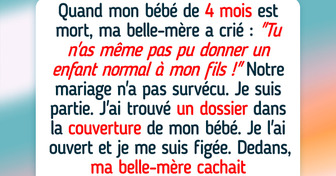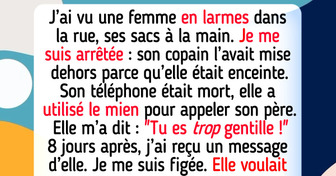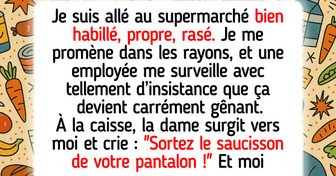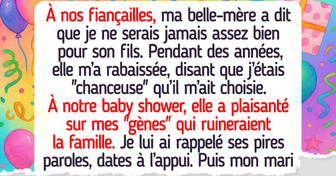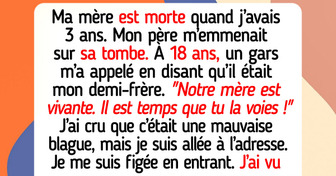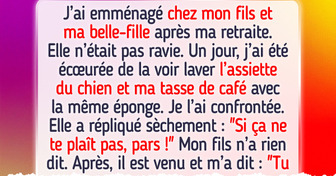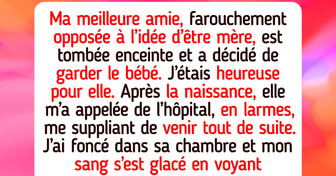15 Hommes qui ont montré leurs photos avant/après avoir pris soin d’eux

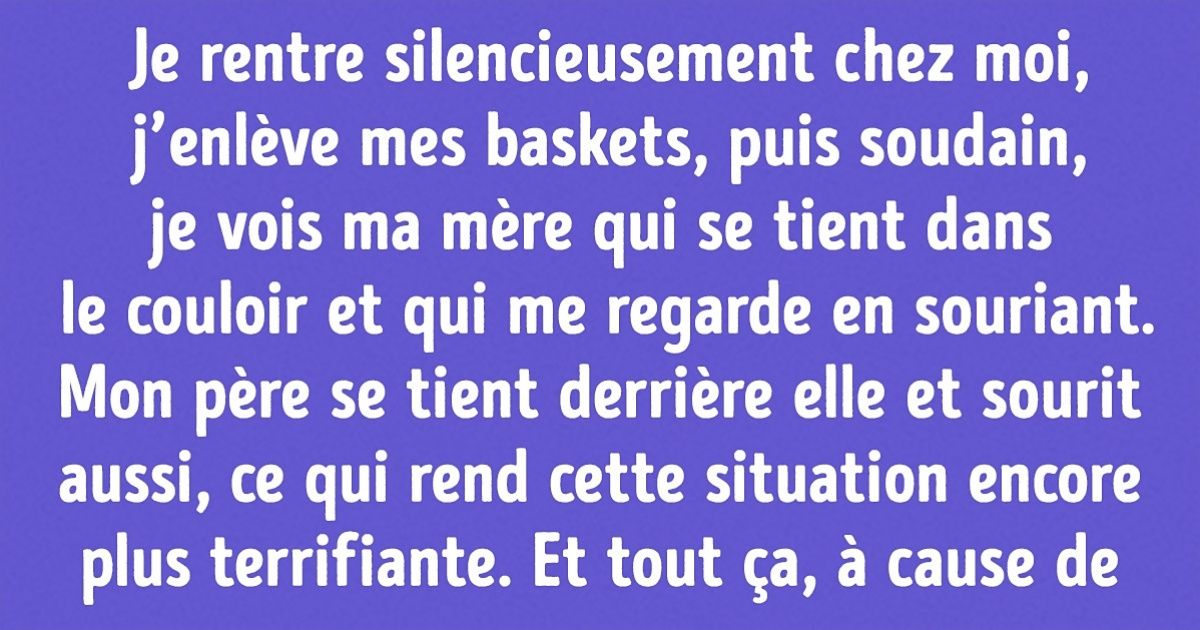
Il est impossible de trouver un adulte qui n’aurait jamais donné de fil à retordre à ses parents durant son enfance. L’écrivain Hector Schultz raconte sa propre histoire et montre que même en faisant de petites farces, nous pouvons, avec le temps, tirer d’importantes leçons qui finiront par porter leurs fruits.
Toute l’équipe de Sympa a adoré cette petite histoire touchante, et nous te proposons de prendre une couverture et de profiter de ce récit avec nous.
J’ai cinq ans et je mène une enfance insouciante où le travail, les hypothèques et les problèmes des adultes sont encore très loin devant. J’ai le monde entier devant moi : il est complètement fou, ouvert, et il change constamment. Et puis, il y a Balou, notre chien de la race terre-neuve, bien qu’à l’époque, on les appelait Saint-Bernard des mers, mais cela n’a aucune importance. Le bocal de trois litres de caviar noir que papa a acheté chez des braconniers et a caché dans le frigo pour une occasion spéciale est bien plus important. Le jour J, ce bocal se trouvait à côté de moi et de Balou, et nous mangions le caviar avec une grosse cuillère brillante. Non, il serait plus juste de dire que nous nous empiffrions ! Je donnais d’abord une cuillère à Balou, qui était très enthousiaste à l’idée d’en recevoir une de plus, puis j’en prenais une à mon tour. Nous étions assis ensemble au milieu de la pièce et nous mangions ce caviar noir : une cuillère pour moi, une cuillère pour le chien, et en avions de la tête au pied. Et nous étions très satisfaits...
Je n’ai pas entendu la clé entrer doucement dans le trou de la serrure. Je n’ai pas entendu mes parents arriver du marcher fatigués et marmonnant quelque chose, mais j’ai entendu le “Oh” de maman, puis une phrase que j’entendrai dorénavant très souvent :
— Voyons, fiston !
Mais moi, je continuais de sourire et de manger le caviar : une cuillère pour moi, une cuillère pour le chien, avec le bocal presque vide qui se trouvait à côté de moi.
J’ai sept ans et j’ai le monde entier devant moi : il est complètement fou, ouvert, et il change constamment. Je suis devenu maintenant un petit farceur : dans ma main gauche, il y a la bouteille de laque pour cheveux de maman, et dans la main droite, je tiens le briquet de papa. Devant moi, sur le bord blanc de la baignoire, se trouvent les soldats en plastique vert que nous avons achetés il y a un an dans un grand magasin de jouets. Il s’agit de prisonniers en attente de leur exécution pour avoir commis des crimes contre les civils. J’allume le briquet et envoie un jet de laque vers la flamme bleu-jaune. En un clin d’œil, le tandem se transforme en un fléau ardent qui fouette les corps des prisonniers. Les soldats se tordent et fondent comme la cire de la bougie épaisse que maman allumait lors des coupures du courant électrique. Les soldats étaient silencieux, mais moi, je ne me retenais pas : je lançais les cris de joie des gagnants et les derniers hurlements des perdants. Lorsque les soldats commencèrent à s’écrouler le long de la baignoire en remplissant l’air d’une odeur de napalm, mes yeux ont commencé à briller avec encore plus d’excitation.
Je n’ai pas entendu la porte s’ouvrir. Je n’ai pas entendu la voix de mes parents. Après tout, je suis un général de l’armée chargé de punir l’ennemi. Tout ce que j’entends, c’est un “Oh” familier et la phrase préférée de maman :
— Voyons, fiston !
Mon excitation se calme, le briquet rouge s’éteint et la bouteille de laque laisse échapper un dernier soupir. J’entends le claquement du placard. J’entends les pas de mon père et le grincement de sa ceinture de cuir.
J’ai neuf ans. Le monde devant moi est complètement fou, ouvert, et en changement constant. Mes joues sont rouges de froid, mes mitaines sont trempées et glacées, tout comme mes pantalons. La semelle de ma chaussure gauche s’est décollée et je tripote le nouveau trou au niveau du genou de mon pantalon. Je souris, je prends un morceau de carton et je cours à toutes jambes vers mes amis qui se trouvent déjà sur notre toboggan de glace improvisé. Quelques secondes plus tard, je me retrouve en train de glisser à la vitesse de l’éclair, en m’accrochant aux bosses de glace avec ma chaussure gauche et en riant quand la semelle ne supporte plus ce trouble et s’envole. Soudain, je m’envole à mon tour et je tombe sur mon genou, en déchirant ainsi le pauvre pantalon et en me blessant au genou. Mais je n’ai pas mal du tout : soudain, j’entends mes amis crier avec admiration et parler de mes manœuvres acrobatiques époustouflantes. Un sentiment de fierté commence à brûler dans ma poitrine.
La nuit tombe vite, et je me dépêche de rentrer à la maison quand j’entends les cris lointains de ma mère qui me demande de rentrer. Je ne vois pas son visage pâlir quand je me montre dans le couloir en enlevant mes vêtements mouillés. Je ne la vois pas froncer les sourcils en se demandant où trouver de l’argent pour acheter de nouveaux pantalons et de nouvelles chaussures. J’entends juste un “Oh” familier et sa phrase préférée :
— Voyons, fiston !
Et me voilà assis à côté du radiateur : je réchauffe mes mains rouges gelées et je regarde par la fenêtre, où le ciel est devenu bleu foncé, et la neige brille comme dans un conte de fées sous le clair de lune. Je sais que mon père va certainement me punir, peut-être même que j’aurais droit à la ceinture pour avoir abîmé mes vêtements, mais je souris quand même. Mes amis se souviendront encore très longtemps de mon envol vers les étoiles.
J’ai quatorze ans. Le monde devant moi est complètement fou, ouvert, et change constamment. Mes amis et mois sommes assis sous un grand mûrier et profitons d’une chaude soirée d’été. Une bouteille de porto à moitié vide est placée au centre de la table, et, autour d’elle, se trouvent des verres ramenés de chez moi et un paquet de cigarettes qui est également à moitié vide. Et, pour couronner le tout, la belle voix confiante de Joseph flotte dans l’air : il joue de la guitare et chante une autre de ses chansons d’amour.
Alice, ma voisine qui, en à peine un an s’est transformée d’un garçon manqué en une véritable beauté, se blottit contre moi. Je la prends dans mes bras et je souris. Je souris à la chaleur, à la chanson de Joseph, à la sensation d’ivresse qui bourdonne dans ma tête et qui force mon cœur à battre la chamade. Et même si, il y a juste un moment, nous jouions à la balle sur le terrain vague et jetions de la boue sur les fenêtres comme de petits enfants, maintenant, nous sommes des adultes sages. Nous sommes des adultes qui se transforment immédiatement en enfants dès qu’ils entendent la voix de leur mère les appeler.
Je rentre silencieusement à la maison, j’enlève mes baskets, et je vois ma mère qui se tient dans le couloir et qui me regarde avec le sourire aux lèvres. Papa se trouve derrière elle et sourit aussi. Cette expression sur leur visage me donne encore plus chaud que le câlin d’Alice. Et tout ça, à cause de l’odeur aigre “adulte” qui émane de moi. L’odeur des cigarettes bon-marché, du porto et celle d’un parfum féminin.
— Voyons, fiston ! — a dit ma mère en souriant. Moi aussi, je souriais. Je hausse les épaules, je me faufile dans ma chambre et je tombe sur mon lit avec les joues brûlantes de honte. Je n’entends pas les voix de mes parents dans la cuisine. Je n’entends pas le bon vieux Balou ronfler. Je dors et dans mes rêves, je vois un monde adulte vif, coloré, et ivre.
J’ai vingt-deux ans. Le monde devant moi est complètement fou, ouvert, et change constamment. Je me tiens dans le couloir portant un grand sac de sport avec mes vêtements et un petit sac avec des sandwiches de poulet froid. Un taxi klaxonne nerveusement à l’entrée, mais je regarde mes parents. Je regarde le visage de ma mère plein d’anxiété et de tristesse, mais qui sourit encore. Elle me serre dans ses bras, pousse son “Oh” habituel et m’ébouriffe les cheveux.
Elle a changé de phrase et dit cette fois : “Tu iras bien, n’est-ce pas ?” Mais dans ma tête, j’entends toujours la même chose : “Voyons, fiston !”
Je ne vois rien. Ni les larmes, ni la tristesse, ni l’angoisse. Juste un taxi qui m’emmènera dans un nouveau monde. Un monde complètement fou qui change constamment. Je fais mes premiers pas sur l’un des chemins qui se sont ouverts devant moi.
J’ai vingt-neuf ans. Le monde devant moi est petit, confortable et calme. C’est mon monde. Ma femme dort tranquillement à côté de moi, et mon fils se trouve un peu plus loin dans son berceau. Parfois, il laisse échapper des mots, d’autres fois, il grogne comme un vieillard, et il renifle de temps en temps comme sa mère. Mais moi, je ne dors pas. J’ai le sommeil agité, je fronce les sourcils, je m’étouffe.
Je me lève, je prends des cigarettes, je me dirige vers la cuisine, et je sors sur le balcon. J’allume mon briquet et je laisse de la fumée s’échapper dans le ciel noir tout en regardant les rues vides éclairées par la lumière des réverbères. Je fume et je réfléchis. Je repense à mon enfance, à mes parents, à ma mère, puis je souris. Je prends mon téléphone et je l’appelle. Elle me répond immédiatement, comme si elle attendait mon appel, et sa voix laisse échapper un sourire. Un très beau sourire avec une petite note de tristesse.
— Je suis allée au marché, m’a-t-elle dit, et moi, j’écoute. — J’ai acheté des pommes de terre et de la viande pour ton père. Je suis tombée il y a quelques jours : je faisais le ménage dans le garde-manger, je suis montée sur le bord de la chaise et je suis tombée.
— Voyons, maman ! — lui-ai-je dit, plein de colère. Mais elle n’a fait que rire.
— Ce n’est pas grave. C’est juste un petit bleu, rien de plus, m’a-t-elle répondu en riant joyeusement, comme une enfant. Moi aussi, je souris, mais avec retenue, comme un adulte. — Et vous, comment allez-vous ?
— Tout va bien, lui ai-je répondu. Puis je lui raconte tout ce qui se passe dans ma vie : le premier mot de mon fils, les difficultés au travail, nos sorties dans la nature. Ma mère pousse ses “Oh” habituels, parfois elle rit, et parfois elle ne dit rien. Moi aussi, je me tais.
J’ai trente ans. Le monde devant moi est petit, confortable et calme. C’est mon monde. Je me trouve sur le balcon et je regarde l’autre monde : il est complètement fou, ouvert, et il change constamment. Il change tout comme moi, et, maintenant, c’est à mon tour de dire cette phrase à ma mère. Est-elle tombée de sa chaise lorsqu’elle nettoyait le garde-manger ? Son cœur a-t-il tenu après une autre de ses disputes avec sa voisine ? Maintenant, c’est elle qui riait, et c’est moi qui secouais la tête en disant :
— Voyons, maman !
— Tout va bien, fiston, — Elle souriait, et ça me faisait sourire à mon tour.
Je l’appelle. Je l’appelle tout le temps.
Pourquoi tu ne dis rien ? Voyons, maman !